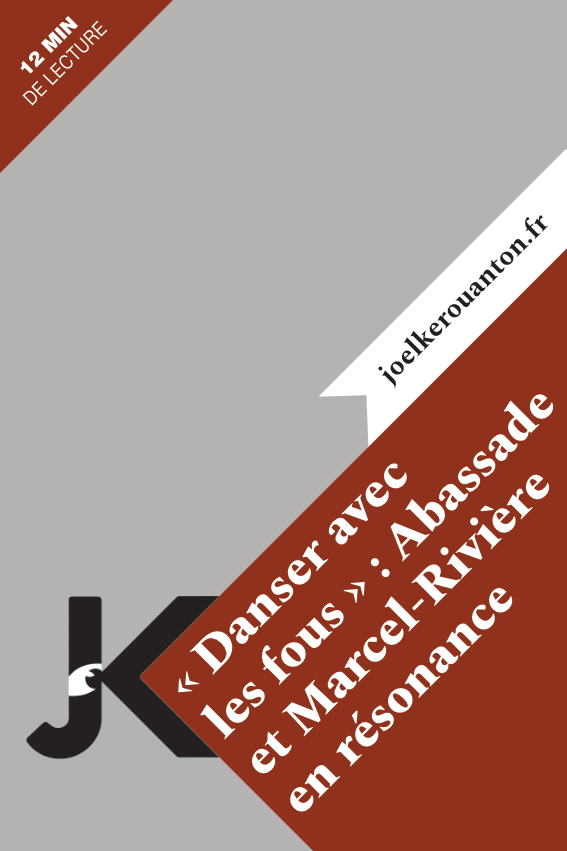DANSER AVEC LES FOUS — Expériences de l’art en milieu psychiatrique à l’Institut Marcel-Rivière (1981-2015), par Madeleine Abassade, aux éditions Langage Pluriel (2025)
DANSER AVEC LES FOUS — Expériences de l’art en milieu psychiatrique à l’Institut Marcel-Rivière (1981-2015), par Madeleine Abassade, aux éditions Langage Pluriel (2025)
Depuis Saint-Alban ou La Borde, on sait que les pratiques artistiques en milieu psychiatrique atténuent la violence symbolique entre soigné·es et soignant·es. L’art humanise le soin. À la lecture de Danser avec les fous, on pourrait dire : l’art ouvre la relation de soin, tant l’opposition ouverture/fermeture traverse cet essai autobiographique à dimension historiographique.
J’ai rencontré Madeleine Abassade en l’écoutant parler. C’était, me semble-t-il, lors d’une microrencontre organisée par la revue Cassandre/Horschamp au couvent des Récollets, à Paris, en 2006. Son propos était limpide, militant et chantant : les pratiques artistiques qu’elle mettait en œuvre à l’Institut Marcel-Rivière (La Verrière) apportaient expressions et imaginaire aux patient·es, réenchantaient la relation thérapeutique et irriguaient le territoire d’implantation de l’hôpital. Doté d’un théâtre de 400 places, l’établissement attirait des habitant·es venu·es de 30 kilomètres à la ronde pour assister à des spectacles ou pratiquer la danse contemporaine en situation « mixte » — malades et non-malades. Un théâtre que Madeleine Abassade décrit comme « lieu du dehors dans le dedans de la folie ».
Je trouvais ça incroyable. La danse faisait danser, d’un même élan, patient·es, soignant·es et habitant·es dans et hors les murs. Tous et toutes formaient des éléments vivants et agissants d’un même rhizome, comme l’écrit Jean-Jacques Lebel dans la préface. C’était une utopie que je n’avais jamais imaginée avant de la vivre en direct, lors d’ateliers et de rencontres professionnelles dans cet hôpital aux murs poreux.
CHRONIQUE D’UNE MORT ANNONCÉE
Plus tard, j’appris que le théâtre était voué à disparaître. Tout passe, tout lasse. Lors de ma venue, en 2007, la « petite porte » reliant l’hôpital au centre-ville de La Verrière venait d’être fermée, la porosité des lieux laissait déjà place à l’imperméabilité. Pour le dire autrement, la mixité sociale — concept clé de Paul Sivadon, fondateur de l’hôpital — cédait à la séparation sociale. C’était peut-être le début de la fin. Le théâtre sera démoli en 2017 : « Massacrée, la scène surélevée comme une boîte ouverte, profonde et large […]. Écrasée, la salle où s’asseyait confortablement le public, avec sa moquette orange entretenue par les hommes de ménage, sa pente douce qui permettait de voir les spectacles depuis les derniers rangs. » Dernière image. Sortie finale. Baisser du rideau. Fin du spectacle.
Madeleine Abassade écrit à la toute fin de son ouvrage : « Ce théâtre a été assassiné. » Comment expliquer qu’une réussite aussi remarquable, tant artistique que soignante, ait été détruite, sans qu’aucune rénovation ni reconstruction n’ait été envisagée pour assurer la pérennité de sa fonction curative — ou, à tout le moins, de dé-marginalisation — alors même que la MGEN, organisme gestionnaire, disposait de caisses pleines ? Pas un euro sur les 100 millions prévus pour la reconstruction de l’hôpital ne sera consacré à ce lieu ni aux projets culturels, tandis que la MGEN égrénait fièrement dans la presse les fameux éléments de langage désormais connus : « Afin d’améliorer le confort et la qualité des prestations aux patients et résidents et de permettre aux équipes de gagner en efficacité, le groupe MGEN a décidé d’engager la reconstruction intégrale des bâtiments ».1
« L’heure est à la gestion des malades, analyse Madeleine Abassade, et non aux politiques inclusives et aux projets qui rassemblent. » « L’univers de la psychiatrie, c’est un miroir grossissant de notre société », aurait ajouté le cinéaste Nicolas Philibert. Il y eut l’assassinat de soignantes par un patient à l’hôpital psychiatrique de Pau. Ce « drame de Pau » fit grand bruit, grand peur, aussi, et grand malheur : un assassinat venait assassiner la politique d’ouverture de la psychiatrie, ouvrant la porte à une politique sécuritaire longtemps rêvée par nos responsables.
À lire ce récit captivant, le théâtre accomplissait pourtant à merveille l’une des premières missions d’un hôpital : protéger. Paradoxalement, on s’y plaçait à l’abri du pouvoir totalisant de la psychiatrie. C’est sans doute pour cela que Madeleine Abassade a pu y travailler trente ans, se sentant protégée autant que les patient·es et les soignant·es. Quand il a disparu, il n’y avait plus de raison d’y rester : l’enfermement devenait totalisant.
DANSER HORS DES STATUTS
Heureusement, Madeleine Abassade convoque les archives pour redonner souffle à cette expérience et inspirer des pratiques futures. D’aucun·es diraient : ce qui fonctionnait dans les années 2000 peut-il être valable aujourd’hui… ? Comme le rappelle Jean-Jacques Lebel, l’horizon reste de « vivre une même expérience sensorielle dans un même espace-temps », un espace non thérapeutique où tolérer la différence devient tolérer la similitude2.
Tolérer la similitude était l’objectif des premiers ateliers de « danse-théâtre soignant·es-soigné·es », où chacun·e portait un masque pour préserver son anonymat. « La différence entre personnes libres ou internées était gommée », écrit l’autrice. Avec le chorégraphe José Montalvo, elle créa de petites formes chorégraphiques qui se diffusèrent hors les murs, dans des festivals, et jusqu’à la clinique de La Borde dirigé par le psychiatre Jean Oury, fer de lance avec François Tosquelles et Lucien Bonnafé de la psychothérapie institutionnelle. Elle réussit à « mélanger, le temps d’une danse, malades et soignants, sans que les spectateurs les distinguent ». Il s’agit d’« échapper à une logique de statut », analysera Jean Oury, qui reçut la troupe de La Verrière avec enthousiasme. Une rencontre décryptée par Madeleine Abassade comme « un temps de la danse, dans une certaine tentative de se défaire des rapports de domination-soumission ».
RÉSISTANCES DU QUOTIDIEN
Être une femme, succéder à un homme, dans un univers fortement patriarcal, ne lui a pas facilité la tâche. Faire vivre un théâtre en milieu psychiatrique, Michel Foucault appellerait ça une hétérotopie artistique. Bien évidemment, les résistances du quotidien se multipliaient, presque imperceptibles, souvent des petits riens : aspirateur passé à l’heure des ateliers, filtre de cigarette coincé volontairement dans un projecteur, hall d’entrée bloqué par des chaises… La menée d’une pratique artistique dans les lieux où l’art ne va pas de soi devient bien plus qu’un projet esthétique : c’est faire éprouver un partage du sensible, peu importe d’où l’on vienne et où l’on part. Même les hommes des équipes d’entretien et d’hygiène sont concernés, malgré leurs réserves (« C’est pas pour nous, c’est pour les malades et les docteurs. ») Et qui sait ? C’est peut-être un jardinier de l’hôpital qui produira du soin — nous sommes ici dans un hôpital qui met au travail la psychothérapie institutionnelle, où chacun·e est porteur, porteuse d’une capacité de soin pour l’autre. Madeleine Abassade organisa des ateliers de danse pour les malades mais aussi les infirmier·res et psychologues, le personnel de ménage et administratif, les serveurs et serveuses du restaurant. Pas étonnant qu’elle ait eu cette chance de côtoyer Jean Oury, Félix Guattari et même Gaston Ferdière, des rencontres racontées avec une écriture précise, concrète et tendue.
UN LIEU DE FABRIQUE ARTISTIQUE
Bartabas, Brigitte et leur cirque Zingaro furent parmi les premiers à sillonner les jardins et les couloirs de l’hôpital. L’établissement offrait aux patient·es et aux artistes une véritable réciprocité transformatrice. Madeleine Abassade illustre cette dynamique avec de menus détails, en faisant émerger au fil du récit des éléments d’archives, comme ce témoignage de Bartabas : « Ces années sans gloire m’ont façonné et m’habitent encore aujourd’hui. Pour toujours. »
Par la suite, Madeleine Abassade privilégia la danse contemporaine pour plusieurs raisons : 1) elle valorise une poétique du corps qui « décille le regard », 2) elle est un « art muet » à l’apparence neutre puisqu’elle se passe de mots et permet d’éviter les phénomènes d’identification psychique et les pulsions destructrices, 3) elle possède une capacité à être très parlante même en ne disant rien, et enfin 4) elle correspond à l’affinité personnelle de l’autrice. Dès son jeune âge et tout au long de sa vie, la danse sera une bouée de sauvetage autant qu’un espace de savoir sensible et universitaire — le livre est émaillé de récits à ce sujet.
Formée par Dominique et Françoise Dupuis, puis Cécile Louvel, et lors de ses études en danse (licence à la Sorbonne, maîtrise à Paris 8), l’autrice apprit à reconnaître les mouvements quotidiens élémentaires — marcher, courir, s’habiller, se déshabiller — issus de la pratique d’Anna Halprin, qui permettent de « faire redémarrer l’élaboration d’un langage gestuel, sans prendre pour fondement aucune des techniques préexistantes ».
On entend, dans les pages de Danser avec les fous, une éthique de travail — au sens où l’autrice se fixe des règles à elle-même pour penser les modalités de relations entreprises avec les patient·es. Elle tient par exemple à ce qu’ils et elles soient associé·es à la diffusion des œuvres créées à l’hôpital, pour « voir ce que les artistes ont fait de l’expérience avec eux ».
Le cirque Zingaro, la metteuse en scène Catherine Azzola, la compagnie Black Blanc Beur, les chorégraphes José Montalvo et Dominique Hervieu, le clown et écrivain Howard Buten, la compagnie de danse verticale Retouramont, le metteur en scène Peter Brook, le photographe et compagnon de longue route Olivier Perrot, des élèves et professeur·es de danse des environs et bien d’autres3 sont venu·es, sont resté·es puis sont reparti·es, construisant, entre l’en-dehors et l’en-dedans de la psychiatrie, la grande histoire de la danse et des arts.
Comme si, au-delà d’être un espace du sensible où chacun·e travaillait à construire du commun, les artistes œuvraient aussi à façonner leur art dans ce lieu non culturel, où « chaque moment artistique crée une ouverture, une anfractuosité dans le réel de l’architecture ».
Témoignages, entretiens et archives photographiques ponctuent l’ouvrage, donnant à voir et à entendre ce qui s’est concrètement joué dans la fabrique des arts en relation avec les soignant·es-soigné·es. De courts textes, placés dans la dernière partie du livre, augmentent le sens du propos général : « Là on parle de fond, bien au fond, tout au fond, celui qu’il nous arrive de cacher parce qu’il montre ce que nous sommes », précise un des artistes invité·es, Fabrice Lévy-Hadida.
COMMENCER DE GRANDES CONVERSATIONS
Madeleine Abassade a travaillé pendant près d’un tiers de siècle à faire de la relation de soin un véritable travail du commun — pour reprendre l’expression du sociologue Pascal Nicolas-Le Strat — en mêlant l’art et la vie au sein d’un hôpital psychiatrique. Même la cafétéria de l’établissement revient à plusieurs reprises dans le récit comme l’un des lieux, aux côtés du théâtre, où patient·es et soignant·es pouvaient regarder, se restaurer, partir, revenir, jeter un œil ou impliquer toute sa personne dans la proposition artistique. « Nous voulions construire une œuvre collective, faire bouger les relations soignants-soignés et permettre aux patients de se produire sur scène », affirme Madeleine Abassade. Jean Garrabé, médecin-chef de l’établissement, commente : « Le théâtre était un espace de liberté. » Dans le même esprit, Fabrice Lévy-Hadida traduit : « Un lieu de liberté où la rencontre entre public et œuvre permet de commencer de grandes conversations. »
Danser avec les fous témoigne du tournant de la psychiatrie au XXI siècle, où le sécuritaire supplante le collectif et néglige le fondement du soin : la création de l’hétérogène. L’éducation populaire et la transformation sociale ne sont plus des terminologies entendues et porteuses. On entend, dans la prose de Madeleine Abassade, quelques regrets, comme cette communauté soignante qu’elle avait pu fabriquer cahin-caha, lors de rencontres ouvertes au sein de l’hôpital, qui cède la place à… rien. Ou quasiment rien. Mais quand même quelque chose. L’once d’un nouveau mouvement4 ?
On lit, dans les dernières pages de l’ouvrage, comment les pratiques artistiques ont « accompagné » ce tournant sécuritaire. On aurait aimé un état des lieux actuel dans l’Hexagone, comme sur les pratiques artistiques en Établissement et service par le travail (ESAT) qui commencent aujourd’hui à se structurer et à se professionnaliser, ou sur le Centre national pour la création adaptée (CNCA) récemment ouvert à Morlaix, augurant une nouvelle approche dans l’accès à la pratique artistique en offrant un cadre de création, de résidence et de diffusion. Sans se substituer à la prise en charge psychiatrique clinique, ces initiatives proposent des espaces de création, de reconnaissance et de participation culturelle des personnes en situation de handicap psychique. Mais ce n’est pas l’objet de ce livre : il ne mène pas une recherche comparative, mais revient sur une expérience singulière.
On entend souvent (trop ?) la parole de l’autrice sur les patient·es, tandis qu’on aimerait percevoir ce que la danse fait à leurs paroles. À sa décharge, elle écrit comme une artiste qui éprouve ce que les patient·es lui font. Ce qu’elle affirme pour les artistes vaut pour elle-même : elle montre qu’elle agit sur la réalité et la transforme en matière symbolique qu’est ce livre. Sa subjectivité affirme son engagement, et révèle la part sensible qui rend les choses et les évènements entendables. Elle n’édulcore pas. Ce qu’elle a créé — car, en fin de compte, Danser avec les fous est le récit d’une création microsociétale —, elle le signe pleinement.
On le sait, que l’autrice cherche à dire la réalité et à la faire entendre par le sensible. Ce point de vue des patient·es, qui semble manquer, surgit pourtant au détour d’une page, où soudain, le « tableau » est là, face à soi, et ça parle. Les mots de l’autrice s’ouvrent et jaillissent pour dire ce qui se joue au sein du huis-clos-atelier, « Danser avec E. qui avait décidé de ne plus parler et qui souillait les murs de sa chambre, se tient le dos courbé et les mains en avant comme prêt à se défendre ou attaquer. Qui se méfie, mais jamais ne manque, et maintenant parle tout bas, nous obligeant à l’écouter. »
QUAND UNE VIE RENCONTRE UN LIEU
On en vient à la pierre de touche : comment une aventure créative aussi longue, aussi complexe (et aussi belle) peut-elle advenir dans un lieu de relégation comme l’Institut Marcel-Rivière ? Cela tient à une personne — Madeleine Abassade — tout comme La Borde tient à Jean Oury, Saint-Alban à François Tosquelles ou l’hôpital du Rouvray à Lucien Bonnafé. Il s’agit sans doute de la résonance entre une histoire de vie et l’histoire d’un lieu, l’une et l’autre en constante métamorphose, selon « ce qui se présente », pour reprendre les mots de Tosquelles.
On aurait aimé qu’il en soit autrement. Que ces aventures, qui organisent le collectif et le sensible comme espace de soin, puissent être générées et accompagnées par un collectif sensible. Or ce n’est, paradoxalement, jamais le cas — au grand dam des politiques qui espèrent parfois la duplication de telles aventures dans des déclinaisons de quelconques programmes nationaux Culture à l’hôpital.
On en conclu qu’il a fallu une part de folie à Madeleine Abassade pour trouver, dans le creux d’un hôpital psychiatrique, assez de pulsion de vie pour faire danser les corps. Et il a fallu une grande intelligence des équipes de l’Institut Marcel-Rivière pour comprendre que se soigner passe aussi par le soin porté à l’hôpital lui-même. Peu d’établissements psychiatriques ont cette conscience : les pratiques artistiques participent pleinement du soin institutionnel et produisent, dans un même mouvement dansant, de véritables effets thérapeutiques. Parce que l’espace artistique invite, pour l’autrice, à « ne pas rompre le lien, en invitant chacun à jouer ensemble au jeu de l’art ».
Dans ce livre, Madeleine Abassade parle des patient·es autant que d’elle-même — et c’est sans doute là que résident la rareté et la force de Danser avec les fous, dédicacé en creux à Camille Claudel, sa sœur de cœur, ainsi qu’à sa grand-tante disparue dans les béances de l’institution psychiatrique. L’action de Madeleine Abassade, finalement, se condense en ces mots simples — adressés aux patient·es autant qu’à elle-même ? : « Envoyer un signe profondément vivant aux personnes malades, les relier au collectif, ne pas les laisser tomber dans leur solitude. »
NOTA BENE : L’écriture inclusive est utilisée dans cet article, à l’exception des citations, toutes issues de Danser avec les fous et reproduites sans modification.
AUTRE PARUTION DE L’AUTRICE : Danser l’imprévu – Une lecture politique et sensible des Cahiers de Vaslav Nijinski, préface d’Anne Boissière, postface d’Aurore Després, Paris, Les presses du réel, 2022.
« Au travers d’une nouvelle lecture minutieuse des Cahiers de Vaslav Nijinski, qu’on qualifia de »fou », et en les sortant de la réduction au diagnostic psychiatrique dont ils sont encore l’objet, Madeleine Abassade fait apparaître la révolte du danseur contre un ordre établi dont il fut l’instrument et dont il cherchera à s’émanciper en créant ses propres chorégraphies. »
- Batiweb, « Le projet de reconstruction à 100 millions d’euros de l’Institut MGEN de La Verrière », 9 septembre 2015 : https://www.batiweb.com/actualites/vie-des-societes/le-projet-de-reconstruction-a-100-millions-d-euros-de-l-institut-mgen-de-la-verriere-27002
- Joël Kérouanton, « J’ai l’inconvénient d’être psychiatre », 2018, https://www.joelkerouanton.fr/ouvrage/jai-linconvenient-detre-psychiatre-12-min/
- L’auteur Jean-Claude Carrière, le comédien Sotigui Kouyaté, le metteur en scène Jean-Pierre Chrétien-Goni, le musicien Jean-Jacques Milteau, le cinéaste Christian Lajoumard, le musicien Claude Sicre et ses Fabulous Trobadors et les Bombes 2 bal, les poètes Julien Blaine et Jean-Jacques Lebel, l’historienne Jacqueline Cahen, le chanteur Bertrand Belin,…
- Josette Petitjean, Brigitte Grateau et Corinne Frisone, infirmières à l’hôpital de jour de l’Institut national MGEN Marcel-Rivière et CMP à l’institut de La Verrière : « Aujourd’hui, il n’y a malheureusement plus d’artistes dans cet hôpital. Riches de nos précédentes expériences, nous nous sommes orientés vers de nouveaux projets. Ainsi les soignants de l’extra-hospitalier persévèrent et mettent en place deux ateliers avec des intervenants extérieurs : impros théâtre, groupe chant percussions. Ces groupes ont lieu hors les murs de l’hôpital dans les communes voisines. »